Les B.O synthétiques, suite : la nostalgie régressive en prise avec la logique de marché
Ou quand le futur dystopique d'hier devient le passé réconfortant d'aujourd'hui.
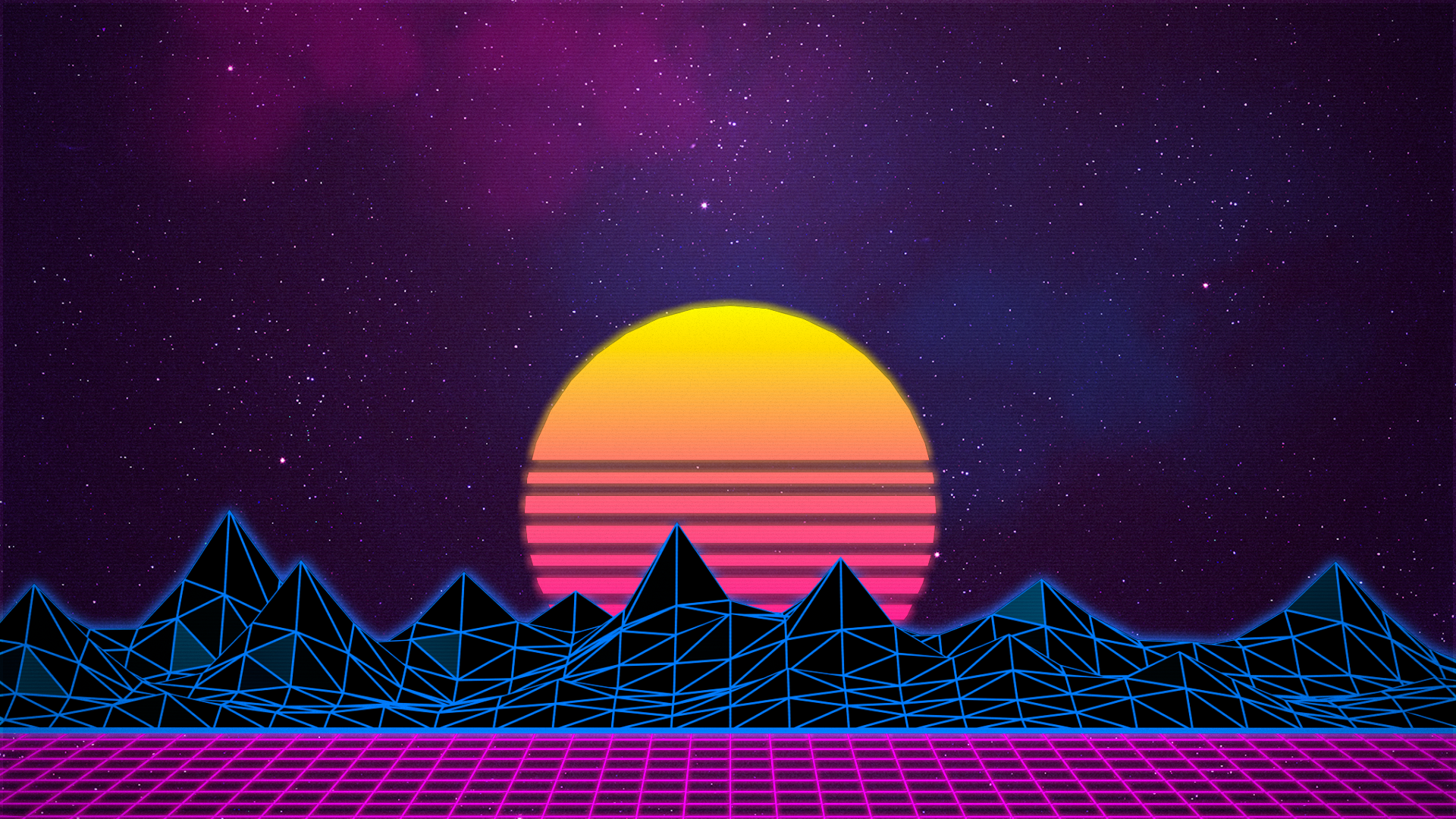
Résumé des épisodes précédents : on vous parlait la semaine dernière du phénomène de la B.O synthétique composée en 2015 qui s'ingénie à sonner comme en 1982. En pointant une incohérence majeure du process qui pousse musiciens et producteurs à se lancer dans l'exercice du pastiche : le futur ne passe pas deux fois. Retour sur le phénomène, en s'intéressant cette fois à la rencontre entre un avenir fantasmé et un présent flippant, aux implications économiques du retour en force de la musique de synthétiseur et en s'interrogeant sur ses implications artistiques.
D’UN FUTUR FANTASMÉ À UN PRÉSENT ANGOISSÉ
Madeleine de Proust pour trentenaires gentiment régressifs, confortable refuge dans un passé idéalisé en réaction à un présent anxiogène, recette éculée pour pallier un vide créatif généralisé : il y a indéniablement de tout cela (et même un peu plus, on y vient) dans la vogue de la B.O synthétique. Mais un autre phénomène, plus rarement souligné, est aussi à l'oeuvre.
Le retour au premier plan des B.O synthétiques correspond à un mouvement enclenché depuis une cinquantaine d'années : la rencontre entre un futur longtemps fantasmé - et redouté - par les créateurs du passé et un présent qui lui ressemble trait pour trait. L'omniscience toute-puissante de Big Brother, la progressive tombée en désuétude de l'idéal démocratique, le retour en force du religieux, l'avènement de "l'ère de la singularité" : autant d'hypothèses et de fantasmes présents en toile de fond d'une partie des chefs-d'oeuvre sci-fi de la charnière 75-85 qui, loin d'être restés à l'état de conjectures, deviennent des réalités tangibles dont on pourrait énumérer les manifestations concrètes, entre montée des populismes en Europe, élection de Donald Trump aux Etats-Unis et état d'urgence permanent.
Pour rappel, l'action de Robocop se situe "dans un futur proche", celle de Terminator en 2029, et celle de Blade Runner en 2019. On y arrive vite. Pas encore de robot-flic (quoique), de voyages temporels ou de vélos volants, mais les grandes dynamiques de fond sont à l'oeuvre. En d'autres termes, ce qui à la sortie des salles de cinéma faisait fantasmer les enfants d'alors (nos fameux trentenaires d'aujourd'hui) n'a jamais vraiment pris corps, mais ce qui devait laisser un sale goût dans la bouche de leurs parents nous arrive droit dessus.
Drôle de paradoxe qui veut que le passé réconfortant de la génération 75-85 soit en partie composé d'oeuvres dystopiques. Et autre lecture du retour en vogue de ces B.O : on peut déplorer la paresse créative des compositeurs et réalisateurs contemporains mais on peut aussi célébrer la prescience dont ont fait preuve ceux d'hier. Comme ils l'avaient anticipé, la musique non-organique, figée, rétive à toute forme d'improvisation - en un terme à la mode, post-humaine - accompagne remarquablement bien notre réalité contemporaine. Le futur qu'ils craignaient devient notre présent, leur musique la nôtre.
Par ailleurs, ce constat donne un début d'explication au manque d'inventivité et de nouvelles propositions dont souffre la pop d'aujourd'hui : la créativité c'est, au moins en partie, la capacité à imaginer, façonner, voire devancer le futur. Si les sociétés des années 50 à 80 ont pu avoir une idée qui se révèle assez précise de ce qu'allait être leur futur, bien malin celui qui aujoud'hui arriverait à prédire ce que sera notre condition dans quatre à cinq décennies. Les genres du cinéma et de la littérature d'anticipation ont d'ailleurs beaucoup moins cours aujourd'hui qu'il y a quelques décennies, sauf s'il sagit de sequels ou de reboots.
Deux pistes donc, pour expliquer ce retour de la B.O synthétique : un essoufflement généralisé de notre capacité - ou de notre envie - de nous projeter dans l'avenir ; la reprise d'un dialogue interrompu entre des compositeurs longtemps relégués au rang de créateurs kitschs et grandiloquents et une jeune garde de réalisateurs et de musiciens qui puisent dans cette mine d'idées, en réactualisant des arrangements, des outils et une esthétique trop rapidement laissés en jachère. Quand Peter Baumann, ex-clavier de Tangerine Dream, nous déclare lors d'une interview que l'imitation ne le dérange pas car elle est le "la plus haute forme de flatterie", on serait tenter d'ajouter : et de validation.
NICHY BUSINESS
Comme la nature, les majors de l'industrie de la musique et du film ont horreur du vide et l'essoufflement créatif n'a jamais été une raison valable pour arrêter la production. Au contraire, ce phénomène a été compris, analysé et rentabilisé du Stranger Things de Netflix au Blade Runner 2049 de Sony, entre calcul cynique et boulot de vrais passionnés. Car au coeur de cette stratégie du business de la nostalgie, on trouve une logique qui dépasse le cadre du marché de la musique pour atteindre toute l’industrie culturelle : la niche. Rappel rapide, au risque de tomber dans le cours de microéconomie de 1ère année : la niche, c'est la fragmentation de l’audience en un ensemble de petites tribus qui s’agrègent autour de références, de goûts et de codes communs, et qui vivent en quasi-autarcie culturelle.
La sortie du dernier Legowelt va mettre 10 000 personnes en émoi dans l’indifférence totale de leur 1000 voisins fans de turbofolk serbe, qui eux-mêmes seront superbement ignorés par leur 3000 collègues amateurs de boom-bap, ainsi de suite jusqu’à l’infini. Disclaimer à l'intention des commentateurs chafouins : on peut appartenir à plusieurs niches à la fois, être fan de garage australien, de techno allemande et de chanson française. Cependant, ces scènes existent indépendamment les unes des autres et disposent chacune de communauté et d'esthétiques propres.

C'est précisément à cette logique que répond College, le projet de David Grellier dont on parlait dans notre papier précédent : l'évocation d’un patrimoine culturel commun aux gens nés entre 1975 et 1980 et biberonnés à la pop-culture de l’époque. Une niche donc, et qui dans les faits s’assume comme telle : si “A Real Hero”, le morceau que le groupe a placé dans le soundtrack de Drive atteint 30 000 000 de vues Youtube, Grellier a tenu à ne le represser qu’en 300 exemplaires pour sa réédition vinyle, se privant d’une bonne manne de dollars par romantisme et par intégrité : “J'aurais pu en fabriquer trois mille c'est vrai, mais à mes yeux, ça n'aurait pas eu le même sens.”, déclare-t-il en 2011 à Télérama.
Toujours dans cette optique, si Kavinski et College ont marginalement profité de la manne d'argent et de notoriété offerte par Drive, ils ont assez vite retrouvé le circuit des salles de concert et des petits clubs auxquels ils avaient accès avant le film de Winding Refn, et on prédit à peu près le même destin à SURVIVE, le groupe responsable du score de Stranger Things. On peut aussi évoquer le cas de Johnny Jewel (moitié de Glass Candy, patron de Italians Do It Better), viré sans ménagement du pool de compositeurs de Drive pour inadéquation artistique avec le réalisateur Danois.
Un licenciement qui illustre bien la limite entre le score, la musique composée pour un film qui répond à une logique intrinséquement utilitaire, et le soundtrack, la liste de morceaux déjà existants choisis par le réalisateur. Le score est une commande, avec des références, un objectif et un cahier des charges précis à remplir, sur lequel le réalisateur a toute lattitude à raturer, reprendre, modifier. Voire de congédier son auteur si le musicien ne rentre pas dans le cadre.
En définitive, le score synthétique répond à plusieurs impératifs assez éloignés de toute considération artistique. Musique fonctionnelle composable au kilomètre par des faiseurs qui ont compris la recette pour des réalisateurs souvent en service commandé. Stratégie payante pour les majors qui ont senti le bon coup. Plaisir générationnel immédiat pour trentenaires fans de E.T et Robocop.
Mais à cette logique forcément un peu factice s'en ajoute une autre, plus passionnante, qui dépasse le cadre de la musique de film et prend corps dans une bonne partie de la pop contemporaine. Dans une bonne partie, et surtout dans ses recoins les moins évidents, s'opèrent des mouvements de balancier qui remettent en question la notion qui voudrait qu'à chaque période de 5 à 10 ans correspondent un son et une esthétique. Au centre du travail de Winding Refn ou de celui de la boss de Minimal Wave Veronica Vasicka, il y a un jeu sur les symboles, les signes et les fétiches passés, l'un en pervertissant la figure du superhéros classique ou notre perception de l'étranger, l'autre en réinventant a posteriori un genre musical qui n'existait que de manière éparse et diffractée.


