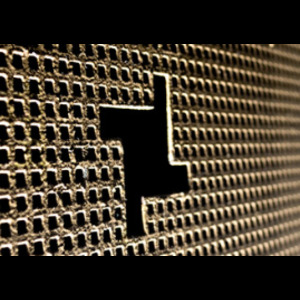Et si Fabric et le Berghain n'étaient que les deux faces d'une même pièce ?
Ce que la fermeture du premier et l'institutionnalisation du second nous disent de l'état de la club culture aujourd'hui.
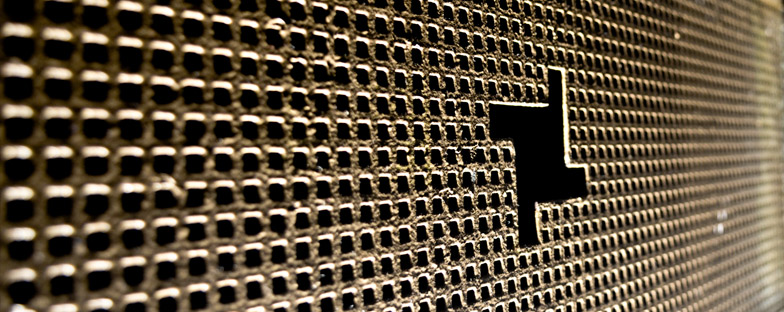
Le 7 septembre 2016, après un bras de fer qui a vu l'ensemble du monde de la musique, l'immense majorité des acteurs du monde médiatique et une partie du monde politique et institutionnel prendre fait et cause pour Fabric, le conseil local d'Islington (l'équivalent de nos mairies d'arrondissement) a révoqué la licence du club londonien, entraînant sa fermeture sans recours possible. Cette décision a marqué le dernier rebondissement d'un feuilleton culturel et judiciaire qui a, un mois durant, occupé toute la presse spécialisée, une partie de la presse généraliste et des pans entiers d'internet : tribune favorable au club du maire de Londres, , coms insultants ou émus d'amateurs de techno ulcérés de se faire sucrer leur club préféré, enquêtes à charge et à décharge de grands quotidiens anglais.
C'est The Independent qui a finalement révélé que la fermeture de Fabric n'était en fait qu'une sombre manoeuvre du conseil d'Islington en cheville avec la police locale - cette dernière ayant été jusqu'à monter une opération d'infiltration baptisée Operation Lenor (jeu de mot niveau maréchaussée : en anglais "Fabric" désigne le tissu et "Lenor" est une marque d'assouplissant) qui n'a servi qu'à constater des actes de vente et de consommation de stupéfiants dans l'enceinte de l'établissement. La mort par overdose de deux jeunes hommes à l'intérieur du club ne fut en fait que le dernier clou dans le cerceuil d'une institution qui était depuis longtemps dans le viseur des autorités locales pour de banales raisons de tranquillité de l'espace public et de non redistribution des recettes au niveau local. 
À notre niveau, on s'est rappelé du très bon, la résidence hebdomadaire de Daniel Avery, les FabricLive d'Omar S ou John Peel, les 10 ans d'Hyperdub ... Du moins bon, les vodka schweppes sans vodka à 15£ pour 15 minutes d'attente, les line-ups semblables à ceux de l'ensemble des méga-clubs et des giga-festivals à travers le monde ... Et du pas bon du tout, les très jeunes filles qui semblaient préparer leur cameo dans Trainspotting, la sécu super tatillone, la désagréable sensation de faire la fête dans le métro aux heures de pointe. Et on s'est demandé si comme Arthur Russell on commençait à vieillir et à être fatigués par la vie nocturne en général, ou si c'est la vie nocturne elle-même qui petit à petit devient à peu près aussi marrante qu'un dimanche après-midi dans un centre commercial du Val d'Oise.
UNE NUIT AU MUSEE
Flash Forward en 2046. Après que les locaux aient successivement été occupés par un Five Guys Burger, un Tesco Mesco puis un salon de thé géant, un consortium contrôlé à parts égales par le board de LVMH, un fonds de pension chinois et les héritiers de Carl Craig rachète l'enceinte de ce qui fut le plus grand club londonien pour en faire un musée dédié à l'histoire de la techno. On peut y admirer des test pressing du premier Mr Fingers, la TR909 sur laquelle Jeff Mills a composé The Bells, une salle entière est dédiée à la collec' complète de vinyles de Moodymann et on peut acheter des cartes postales Greetings From Fabric ou l'autobiographie de Daniel Bell à la boutique souvenir. Le soir de la cérémonie d'ouverture c'est Nina Kraviz qui est chargée du discours d'inauguration - moment d'émotion quand elle évoque la mémoire de Ben Klock, mort de déshydration après avoir joué 98 heures sans pause clope au Berghain - sous l'oeil bienveillant des derniers survivants de Dance Mania, du désormais chevalier des Arts et des Lettres San Proper et de celui qu'on doit dorénavant appeler Lord DJ Harvey - ce n'est pas un nouvel alias, l'anglais baléarique a été annobli et a lancé dans la foulée la première disco after party d'annoblissement en présence de la famille royale. Les convives se marrent en parlant du reste de gramme de kétamine dont le propriétaire a attesté sur l'honneur qu'il a brièvement appartenu à Ricardo Villalobos qui a trouvé acquéreur à 7000£ chez Sotheby's, ce qui reste raisonnable comparé aux 45 000 qu'un acquéreur anonyme a dû lacher pour choper le disque dur contenant les masters de Syro d'Aphex Twin. Fin du discours, dehors Julian Morelli, le fils de Ron et de son attachée de presse, crame tout le catalogue vinyles de L.I.E.S pour protester contre la récupération de la techno - il peut se permettre de cramer à peu près ce qu'il veut, après un bref passage chez Vivienne Westwood sa mère a profité de sa street cred techno pour monter sa marque de sapes de luxe dont les collections sont scrutées à chaque fashion week - mais l'assistance s'en fout, le concert privé de Three Chairs Jr, le reboot de Three Chairs avec les fils des membres originaux, vient de démarrer.
On ne plaisante qu'à moitié : à deux ou trois détails près ce scénario est loin d'être improbable. D'une part parce qu'on a déjà vu des mouvements au moins aussi sales et teigneux que la techno se faire ensevelir sous les honneurs, les rétrospectives et la reconnaissance du monde institutionnel, d'autre part parce que les premiers signes sont déjà là. On pense à la justice allemande qui vient de valider le passage du Berghain dans la tranche d'imposition jusqu'ici réservée aux salle dédiées à la musique classique, à la carte blanche accordée à Jeff Mills par le musée du Louvre, au revival deep house du début des années 2010 qui a vu une partie de la génération des producteurs vingtenaires s'attacher à produire la même musique avec les mêmes machines et passer les mêmes disques que leurs glorieux aînés dans une démarche qui avait plus à voir avec la philatélie qu'avec la création artistique, à Danilov Plessow aka Motor City Drum Ensemble qui consolide sa place parmi les Dj's les plus demandés de la planète en jouant quasi exclusivement de la disco et de la early house millésimées 1975-1995.
Il y a une cohérence historique derrière cette volonté de donner à la musique électronique une place officielle parmi les grands courants musicaux de la seconde moitié du 20ème siècle. Née quelque part entre les expérimentations de Pierre Schaeffer, celles de la New York School, la sortie des premiers Kraftwerk et l'émergence de la disco, elle connaît autant de sous-genres que le jazz et autant de popularité que le rock ou le hip-hop. Mais il ne faut pas oublier que toute sortie de la marge s'accompagne fatalement de son lot de récupérations, de captations d'héritage, et de gros coup de pognons.
303 + 808 + 909 = $$$$
Fabric se trouvait à un autre carrefour autour duquel la house et la techno gravitent depuis près de trois décennies sans jamais passer totalement d'un côté ou de l'autre. Côté pile, la liberté et l'hédonisme d'un courant qui revendique autant ses origines industrielles et prolétaires que son héritage afro-américain, en traçant une généalogie de la Motown à Underground Resistance et de Throbbing Gristle au Trésor. La musique de la communauté gay du Chicago de la fin des années 80, des activistes futuristes de Detroit, des prolos anglais en parkas kakis, de la jeunesse est-allemande assoiffée de nouvelles sensations après la chute du mur. Côté face, l'outil de consommation de masse, bande-son générique des pires afters surpeuplés d'Ibiza où la frontière entre artiste et promoteur est quasi abolie, le DJ devenant un acteur économique au même titre que le limonadier : l'un fournit son nom son aura et sa musique, l'autre son argent, ses boissons et ses outils promotionnels. Accord gagnant / gagnant, le club empoche son chéque, le DJ son pourcentage, le limonadier engrange des points d'image, tout le monde est content, toute considération musicale passe très loin au second plan.
C'est comme ça que l'on peut voir certains de ceux qui ont contribué à façonner et à propager la techno - au hasard Sven Vath, Richie Hawtin ou Luciano - tenir résidence tous les étés à Ibiza. Gros noms, gros clubs, grosses affluences, grosses rentrées d'argent. Hurler au dévoiement d'un genre ou au détournement d'héritage - ce qui reviendrait à hurler sur son grand-père s'il dillapidait la fortune familiale en danseuses et en parties de poker sur internet, c'est lui qui a ramassé et il fait ce qu'il veut - c'est faire un contre sens.
D'abord parce que depuis son origine, le rôle du DJ est simple : faire danser les gens. Que ce soit en passant de la disco aux beautilful people du Studio 54, du gabber aux jeunes marginaux des free-parties ou de la micro-house aux foules en t-shirt col en v / fausses wayfarers des festivals estivaux.
Ensuite parce que cette scène a depuis sa naissance été confrontée à un problème que le mainstream a rencontré au tournant des années 2000 : la nécessité de construire un modèle économique viable sans s'appuyer sur la vente de disques. Dans un milieu où la norme est de de sortir des EP's sous différents pseudonymes sur divers label dans des pressings limités, où l'on joue souvent la musique des autres et où la perspective de passer sur de grosses radios a longtemps parue totalement illusoire on a vite compris que ce n'est pas en attendant des ventes mirobolantes ou des royalties sonnants et trébuchants qu'on paierait son loyer. Ce que font aujourd'hui tous les musiciens - du groupe indie à la pop star globale - à savoir s'appuyer sur les performances lives et les partenariats corporate pour faire entrer de l'argent dans les caisses, les producteurs techno le font depuis 25 ans.
Alors certes, ce partenariat poussé entre propriétaires millionnaires de boîtes de nuit et producteurs nouveaux riches a contribué à une forme de nivellement par le bas d'une partie de la scène électronique - on se souvient de DJ Shadow viré sans ménagement des platines du Mansion de Miami parce que son set était jugé trop expérimental pour satisfaire les millionnaires russes du coin VIP qui claquent des dizaines de milliers de dollars en magnum de champagne. Mais il lui a également permis de ne pas s'éteindre totalement - un revival techno aurait été plus compliqué si tous les historiques avaient lâché leurs machines pour devenir maçons ou livreurs de pizza - et certains comme le Chilien Ricardo Villalobos ont appris à s'adapter aux exigences du clubbing de masse tout en continuant à faire à peu près ce que bon leur semblait, sortir des maxis quasi expérimentaux ou planter sans remords un gig sur deux (meilleure excuse à ce jour : mon after en Roumanie était trop prenante et je n'ai pas réussi à décoller).
BERGHAIN ET FILTRES INSTAGRAM
Autre donnée récente : la nouvelle "coolitude" de la techno. Après avoir longtemps souffert d'une image de musique de beauf (l'axe du mal Sinclar / Guetta / Tiesto), de nerds (l'axe du weird Warp / Aphex / Mills) ou de drogués (l'axe des mâchoires qui claquent Heretik / Spiral Tribe), la musique de club a bénéficié d'un retour en grâce branchouille à la fin des années 2000. Essoufflement prévisible du revival rock, manque d'inspiration passager de la scène indie, sortie du ghetto RFM / boîte de province de la disco par James Murphy et sa bande, brouillage des lignes entre mainstream et underground : toutes les conditions étaient réunies pour un retour au premier plan de la musique de club avec Pedro Winter, Diplo et leurs écuries respectives dans le rôle des vulgarisateurs. 
Ce sont les années où le Social Club ne désemplit pas, où la presse spé s'extasie sur les sorties d'Ed Banger, Institubes ou Mad Decent, où Colette ne vend plus que de "l'electro" et où toute une génération redécouvre le plaisir de s'enfermer dans des caves en bouffant des pilules sur fond de musique jouée trop fort. Ce qui donnera naissance à deux entités séparés, d'un côté la montée en puissance de l'EDM, de l'autre celle du grand revival house et techno des origines.
Aujourd'hui le Social Club est fermé, Diplo co-produit des albums de Justin Bieber avec Skrillex et pas grand monde ne s'intéresse au dernier Justice, si ce n'est pour relever les ressemblances avec Tame Impala. En revanche, un hypothétique retour de la trance met la moitié de l'Internet en émoi, la techno matinée d'influence Basic Channel d'Abdulla Rashim est chroniquée très sérieusement sur Pitchfork, Nina Kraviz partage sa fast life avec ses 362 000 abonnés Instagram, les copains de nos petites soeurs ont tous fait l'acquisiton de platines Technics et le dernier objet de fantasme des jeunes filles en fleur s'appelle Loke Rahbek. Si elle n'a pas (encore?) atteint le statut d'objet pop comme peuvent l'être le dernier album de Beyoncé ou le prochain défilé de mode de Kanye West, la musique de danse fonctionnelle est aujourd'hui quasi unanimement acceptée, décortiquée, analysée, et ce jusque dans ses formes les plus abruptes et complexes. 
Toutes les mutations, les tentations et les errements de la scène électronique de ces deux dernières décennies, Fabric les a accompagnés, vécus ou précédés, au même titre que l'Ostgut Club depuis qu'il est devenu le Berghain en 2004. C'est pour ces raisons que l'on aura du mal à se réjouir de la disparition d'un club emblématique d'un pan entier d'une culture que l'on chérit ici chez The Drone, parfois plus que de raison. C'est pour les mêmes raisons que l'on aura aussi un peu de mal à applaudir des deux mains et des deux pieds cette institutionnalisation à l'œuvre ces dernières années, et que le Berghain personnifie aujourd'hui plus que tout autre. A-t-on réellement besoin des pouvoirs publics pour légitimer une musique qui s'est faite avant tout dans la clandestinité et la confrontation, surtout lorsqu'on parle d'un club qui s'est fondé autour d'une culture gay et hardcore? A-t-on vraiment envie de voir cette endive de Floating Points dérouler un set de "jhââz" tout ce qu'il y a de plus révérencieux pour qu'on prenne enfin sérieusement cette musique et cette culture au sérieux ?
En somme, le tampon high culture n'est-il pas en définitive à double tranchant, et la commercialisation à outrance d'un espace de fête une étape logique, bien que regrettable, pour une culture qui ne cesse de croître de manière exponentielle ? D'un côté, si la fermeture de Fabric doit symboliser quelque chose, ce n'est pas certainement pas que toute la club culture est touchée en son cœur, ni que son futur s'en trouve particulièrement menacé - contrairement à ce que voudraient nous laisser penser certains éditoriaux impayables. Pour le club londonien comme pour le Berghain, on parle tout de même d'énormes machines isolées, avec un business plan quantifié, chiffré, rationalisé, de grosses salles à remplir et des tiroirs caisses à faire tourner. Ce qui nous semble évident, c'est que ces deux institutions, à des degrés divers, sont avant tout le fruit, non pas d'un état d'embaumement (il ne faut quand même pas déconner), mais d'une certaine pente de sanctuaristation doucement mais sûrement à l'œuvre dans la musique électronique. Et, quoi qu'on en dise, que la prochaine révolution musicale populaire ne viendra certainement pas du coin VIP d'un club géant, des bureaux de la direction d'un musée ou d'une agence de planning stratégique.